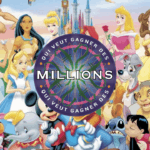En 2024, les plateformes de streaming dont Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV et Crunchyroll ont investi un montant record de 397 millions d’euros dans la création audiovisuelle et cinématographique française, représentant une progression significative de 17,8% par rapport à l’année précédente. Cette évolution majeure place désormais la SVOD comme contributeur de 25% du financement total de la création audiovisuelle en France, conséquence directe de la directive européenne et du décret français de 2021 qui imposent aux plateformes étrangères d’investir au minimum 20% de leur chiffre d’affaires réalisé en France dans la production locale.
Points clés à retenir
- Sur les 397 millions d’euros investis, 317 millions sont dédiés à la production audiovisuelle et 80 millions au cinéma.
- Netflix demeure le principal contributeur avec environ 222 millions d’euros investis dans la création française.
- De nouveaux acteurs comme Paramount+ et HBO Max (Max) devraient rejoindre ce cercle de financeurs en 2025, renforçant davantage le soutien à la production locale.
- 89% des financements bénéficient à des œuvres d’expression originale française, et 67% sont orientés vers la production indépendante.
- Malgré cette tendance positive, un ralentissement de la croissance est anticipé pour 2026, en raison notamment d’un repli du marché publicitaire.

Un record historique pour la création française en 2024
En 2024, la création audiovisuelle et cinématographique française atteint un nouveau sommet historique grâce à l’engagement massif des grandes plateformes de streaming. Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV et Crunchyroll ont ainsi investi un montant exceptionnel de 397 millions d’euros dans la production locale. Ce chiffre, révélé par l’Arcom, constitue une progression significative de 17,8% par rapport à l’année précédente, où les investissements s’élevaient à 337 millions d’euros.
Cette augmentation témoigne d’un tournant majeur dans le financement de la création française. La SVOD (Subscription Video On Demand), qui regroupe ces plateformes, représente désormais 25% du financement total de la création audiovisuelle en France, tandis que les chaînes traditionnelles conservent une part majoritaire de 75%. Cette évolution traduit la montée en puissance des plateformes numériques dans un secteur en pleine mutation, où la diversité des sources de financement devient un enjeu crucial pour soutenir la richesse culturelle française.
Le contexte législatif et réglementaire joue un rôle fondamental dans cette dynamique. La directive européenne et le décret français de 2021 ont imposé aux plateformes étrangères une obligation d’investissement dans la production locale, favorisant ainsi une meilleure intégration de ces acteurs dans l’écosystème audiovisuel national. Dans cet article, nous analyserons d’abord le cadre réglementaire qui encadre ces investissements, avant de détailler la répartition des financements et le poids des différents acteurs. Nous évoquerons ensuite l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, ainsi que les impacts de cette politique sur la diversité culturelle et la production indépendante. Enfin, nous conclurons par une réflexion sur les perspectives et enjeux à venir pour la création française.
Cadre réglementaire : la directive européenne et le décret de 2021
Depuis juillet 2021, un cadre légal strict encadre l’investissement des plateformes étrangères dans la création audiovisuelle française. En effet, la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, transposée en droit français via un décret, impose aux plateformes de streaming une obligation d’investir au minimum 20% de leur chiffre d’affaires réalisé en France dans la production locale. Cette mesure vise à garantir un financement équilibré entre les groupes de télévision traditionnels et les nouveaux entrants numériques, tout en préservant la diversité culturelle nationale.
Cette obligation concerne une large gamme d’œuvres, incluant les séries, films, documentaires, spectacles vivants et autres créations originales. Elle a pour but de diversifier les sources de financement de l’audiovisuel français, historiquement dominé par les chaînes traditionnelles, et d’assurer une meilleure représentation des œuvres françaises sur les plateformes internationales. Ainsi, les géants du streaming sont désormais incités à soutenir activement la création locale, ce qui contribue à renforcer la production et la diffusion de contenus typiquement français.
Le décret de 2021 précise également les modalités de répartition des investissements, favorisant notamment les productions originales et indépendantes. Cette réglementation garantit une meilleure transparence et un contrôle accru des engagements financiers des plateformes, afin d’éviter les dérives et de maximiser l’impact culturel et économique de ces investissements. Cette harmonisation réglementaire entre acteurs traditionnels et numériques est une étape clé pour assurer la pérennité de l’exception culturelle française à l’ère du numérique.

Répartition des investissements et poids des acteurs
Sur le total des 397 millions d’euros investis par les plateformes en 2024, la majeure partie, soit 317 millions d’euros, est dédiée à la production audiovisuelle. Cette catégorie englobe les séries, fictions, spectacles vivants et autres formats télévisuels. Le reste, environ 80 millions d’euros, est consacré au cinéma, un secteur traditionnellement plus dépendant des financements publics et privés français.
Parmi les acteurs, Netflix reste le principal contributeur, avec un investissement estimé à environ 222 millions d’euros. Cette position dominante reflète la stratégie agressive de la plateforme pour renforcer sa présence sur le marché français, en produisant des séries à succès et des contenus originaux adaptés aux goûts locaux. Viennent ensuite Disney+, Prime Video et Apple TV, qui ont également accru leurs investissements pour répondre aux exigences réglementaires et conquérir une audience croissante.
Il est à noter que la répartition exacte des investissements par plateforme demeure confidentielle, mais les données disponibles indiquent une concentration des financements autour des acteurs majeurs du secteur. Cette concentration soulève des questions sur la diversité des financements et la place laissée aux acteurs plus modestes ou émergents. Cependant, la tendance générale montre une augmentation globale des ressources allouées à la création, ce qui profite à l’ensemble de l’écosystème audiovisuel français.
Un nouvel équilibre avec l’arrivée de nouveaux acteurs
Le paysage de la création audiovisuelle française est en pleine recomposition, avec l’arrivée de nouveaux acteurs qui viennent renforcer la concurrence et élargir le champ des financements. En 2025, la plateforme Paramount+ devra également se conformer à l’obligation d’investir 20% de son chiffre d’affaires français dans la production locale, rejoignant ainsi le cercle des grands contributeurs.
Par ailleurs, le lancement en 2024 de HBO Max (rebaptisée Max) annonce une prochaine application de cette règle à ce nouvel entrant, qui devrait rapidement s’imposer sur le marché français. Cette évolution promet un rééquilibrage du rapport de force entre plateformes et chaînes traditionnelles, en consolidant la place des acteurs numériques tout en maintenant un soutien fort à la création locale.
Cette diversification des acteurs implique également une plus grande variété de contenus et de formats, permettant d’explorer de nouvelles thématiques et de toucher des publics plus larges. En intégrant ces nouveaux venus, le marché français renforce sa résilience face aux mutations rapides du secteur audiovisuel mondial. Pour en savoir plus sur les stratégies de Disney+, vous pouvez consulter cet article dédié à Disney Channel Europe et son impact sur la production locale.

Impact sur la diversité et la production indépendante
Un aspect essentiel de ces investissements est leur contribution à la diversité culturelle et au soutien de la production indépendante. Selon les chiffres récents, 89% des financements des plateformes bénéficient à des œuvres d’expression originale française, ce qui confirme leur engagement à promouvoir des créations authentiquement locales. De plus, 78% des investissements sont destinés à des films inédits, favorisant ainsi la découverte de nouveaux talents et la mise en avant de productions originales.
La part accordée à la production indépendante est également significative, avec 67% des financements orientés vers ce secteur. Cette dynamique contribue à préserver l’exception culturelle française, en permettant à des structures plus petites de s’inscrire dans un circuit de production et de distribution souvent dominé par les grands groupes. Les plateformes respectent, voire dépassent, les exigences du décret SMAD (Services de médias audiovisuels à la demande), garantissant un équilibre entre contenus commerciaux et œuvres d’auteur.
Ce soutien à la diversité des contenus est crucial dans un contexte où les plateformes tendent à uniformiser leurs offres pour atteindre un public global. En France, la réglementation et l’engagement financier des acteurs numériques favorisent une richesse culturelle qui bénéficie à l’ensemble des spectateurs. Pour approfondir le rôle de Disney dans la promotion des œuvres françaises, vous pouvez consulter cet article sur Walt Disney Studios et leur implication dans la production locale.
Perspectives et enjeux pour l’avenir
L’Arcom salue globalement le respect des obligations par les plateformes et leur intégration croissante dans l’écosystème audiovisuel français. Malgré certaines tensions persistantes entre acteurs traditionnels et numériques, l’année 2024 confirme une dynamique positive en faveur de la création locale. Les perspectives pour 2025 restent favorables, avec l’arrivée de nouveaux acteurs et la consolidation des investissements.
Cependant, un ralentissement de la croissance est anticipé en 2026, en raison notamment d’un repli du marché publicitaire et d’une baisse probable des subventions publiques. Ces facteurs pourraient freiner les capacités d’investissement des plateformes et des autres financeurs, posant de nouveaux défis pour la pérennité de la création française. Il sera donc essentiel de poursuivre les efforts pour maintenir un équilibre entre innovation, diversité culturelle et viabilité économique.
Dans ce contexte, les professionnels du secteur sont invités à rester vigilants et à encourager des politiques publiques adaptées, favorisant la collaboration entre tous les acteurs. La réussite de cette transition numérique dépendra en grande partie de la capacité à préserver la richesse et la spécificité culturelle françaises tout en intégrant les évolutions du marché mondial. Pour suivre les actualités et analyses sur le cinéma et les séries, vous pouvez visiter cette page dédiée à l’actualité cinématographique.

Conclusion
En 2024, la création audiovisuelle et cinématographique française franchit un cap historique grâce à l’investissement record de 397 millions d’euros des plateformes de streaming. Cette progression de 17,8% par rapport à 2023 illustre l’impact concret de la directive européenne et du décret français de 2021, qui imposent aux acteurs étrangers une obligation d’investissement local. Ce cadre réglementaire a permis de diversifier les sources de financement et de renforcer l’intégration des plateformes dans l’écosystème audiovisuel français.
La répartition des investissements favorise majoritairement la production audiovisuelle, avec un poids important de Netflix, suivi de Disney+, Prime Video et Apple TV. L’arrivée prochaine de Paramount+ et HBO Max devrait accentuer cette tendance, rééquilibrant le marché entre plateformes et chaînes traditionnelles. Par ailleurs, ces financements soutiennent fortement la diversité culturelle et la production indépendante, préservant ainsi l’exception culturelle française.
Face aux enjeux futurs, notamment un possible ralentissement économique en 2026, il sera crucial de maintenir un dialogue constructif entre acteurs publics et privés. Les efforts pour encourager la créativité, l’innovation et la diversité doivent se poursuivre afin d’assurer la pérennité et la vitalité de la création française. Pour approfondir votre connaissance de la production Disney et ses affiches emblématiques, n’hésitez pas à consulter ce quiz culturel sur les affiches de films Disney.